
La première grande idée de Saint-Yves d’Alveydre, le pilier de sa doctrine synarchique, c’est la distinction entre les notions d’autorité et de pouvoir.
Dans l’usage courant, les deux mots s’emploient l’un pour l’autre sans qu’on songe à les différencier. Il existe cependant un usage du mot « autorité » non identifié à la notion de pouvoir, et qui n’implique pas l’idée de contrainte.
L’essence de l’autorité sociale
Selon l’étymologie, l’autorité est ce qui autorise, et le pouvoir est ce qui peut. Intuitivement, on sent que le mot « autorité », pour reprendre la définition qu’en donne le dictionnaire Littré, sous-entend « une nuance d’influence morale » qui n’est pas nécessairement impliquée dans le pouvoir. Ainsi, une autorité qu’on remet en cause est attaquée dans son droit à être appelée « autorité », car il n’existe d’autorité que reconnue et acceptée, alors qu’un pouvoir ne requiert pas l’adhésion obligatoire des gouvernés pour imposer son existence. Il est aisé de voir l’opposition entre le pouvoir, qui exerce la contrainte par la force, et l’autorité, porteuse d’un ascendant moral, qui se déploie uniquement par le respect qu’elle inspire.

La différence est clairement établie par Saint-Yves d’Alveydre, dans le chapitre des définitions au début de sa Mission des Souverains. L’autorité, de nature uniquement morale et spirituelle, ne se fonde jamais sur la contrainte. Dès qu’elle recourt à la force, elle se perd en se confondant avec le pouvoir. Pour éclairer la distinction autorité-pouvoir, rien ne vaut l’explication suivante que livre Saint-Yves[1] :
À l’heure actuelle, l’Autorité, quoique diffuse, quoique non constituée, réside dans quiconque enseigne à qui que ce soit quelque chose d’utile, dans le premier des savants et dans la dernière des mères de famille, dans le premier des docteurs religieux ou laïques et dans le dernier des pauvres curés, pasteurs, popes, rabbins ou pédagogues de village.
C’est ce vague sentiment qui, mal formulé dans la conscience du révolutionnaire sincère, le fait se dresser, à l’honneur du Genre Humain tout entier, contre les Pouvoirs arbitraires qui foulent aux pieds l’Autorité.
J’ai assez prouvé que je n’étais pas révolutionnaire, pour avoir le droit de m’élever contre l’arbitraire qui perd l’Autorité, en la confondant sous forme administrative et officielle avec les Pouvoirs gouvernementaux.
Rapprocher tous les enseignements dans un seul et même Conseil de l’instruction et de l’éducation publiques, c’est redresser l’Autorité sur ses bases éternelles, c’est par conséquent rendre au Pouvoir politique le contrôle arbitral et l’autorisation qui lui manquent.
Tout est dit, ou presque, dans ces lignes remarquables de concision et de clarté.
L’autorité n’appartient pas à la force ; son caractère essentiel est d’être désarmé des sanctions exécutives propres au pouvoir. Elle ne s’impose que par son rayonnement moral et intellectuel. Si le pouvoir dispose de la force, l’autorité ne compte que sur le respect qu’elle inspire, notamment lorsqu’elle met sa connaissance au service d’autrui. Elle ne contraint pas, elle éclaire et avertit, elle éduque et instruit ; elle ne juge que pour guérir et perfectionner.
Pour préserver leur capital d’influence, les enseignants comme les prêtres ne doivent relever que d’associations libres. L’autorité ne doit jamais vivre sous la dépendance d’un quelconque pouvoir politique, sous peine d’abaisser et d’avilir cet ascendant qui mérite le respect.
Séparer l’autorité intellectuelle du pouvoir politique
La séparation des deux instances est parfois institutionnalisée par une distinction entre le « chef » et le « sage ». Dans la Chrétienté du Moyen Age, le pouvoir suprême, au sommet de la hiérarchie sociale, était divisé entre la Papauté et l’Empire. En Orient, une telle séparation est fréquente dans certaines conceptions hindouistes et bouddhistes. L’autorité a pris la forme religieuse dans l’Occident médiéval, mais l’étendue de son domaine dépasse celui du culte. Cette fonction, actuellement morcelée en instances séparées, englobe des composants qui n’ont rien de religieux, notamment depuis qu’un grand schisme culturel a séparé en Occident la religion, la science et la philosophie.
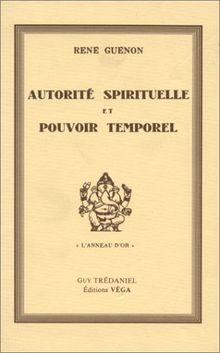
Dans son ouvrage Autorité spirituelle et Pouvoir temporel, René Guénon désigne les deux instances par les noms de « pouvoir sacerdotal » et « pouvoir royal », tout en précisant que les termes « sacerdotal » et « royal » n’impliquent pas que l’autorité doive toujours être exercée par le sacerdoce ni que le pouvoir politique soit toujours détenu par un monarque ; c’est la fonction qui détermine l’institution, et non l’inverse. Néanmoins, pour marquer la différence, Guénon emploie plus volontiers, s’agissant de l’ordre spirituel, le mot « autorité » plutôt que celui de « pouvoir », qui convient plus proprement à l’ordre temporel et qui évoque l’idée d’une puissance matérialisée par l’emploi de moyens extérieurs. À l’inverse, l’autorité s’affirme en l’absence de tout appui sensible ; sa puissance toute intellectuelle se fonde sur la seule force de la vérité et de la connaissance[2]. Une autorité authentique n’a besoin d’aucun appui extérieur pour s’imposer, et surtout pas de la violence. Dans les civilisations où a prédominé une classe sacerdotale distincte de la royauté, comme dans les cités grecques antiques, cet ordre s’est imposé sans aucun soutien extérieur[3]. En Inde, le brahmane ne doit solliciter l’aide ni d’un prince ni d’un guerrier[4].
Séparer l’autorité intellectuelle du pouvoir économique
L’indépendance de l’autorité se pose vis-à-vis du pouvoir politique, mais également vis-à-vis du pouvoir économique. On entend dire de nos jours que l’école doit s’adapter à la société. Gaston Bachelard, conscient de l’enjeu, soutient la position inverse : « la Société sera faite pour l’École et non pas l’École pour la Société »[8]. Au reste, l’adéquation totale de l’enseignement aux besoins ponctuels de l’économie, qui assujettit l’autorité enseignante à la démagogie du patronat, est illusoire ; l’évolution permanente de la société appelle non pas à formater des spécialistes dans un but utilitaire à court terme, mais à développer l’autonomie individuelle pour former des esprits capables de faire face aux changements.
La légitimation du pouvoir
Dans un organisme sain, l’instance politico-administrative, tout en restant autonome dans son domaine, tient sa légitimité de l’instance intellectuelle. Saint-Yves d’Alveydre le répète à de nombreuses occasions : c’est à l’autorité sociale, représentée par l’assemblée de tous les corps enseignants, que revient le droit d’autoriser le pouvoir, de légitimer ses détenteurs après les avoir sélectionnés selon leur valeur, de le contrôler et, au besoin, de le corriger. En l’absence d’autorisation et de contrôle par une autorité indépendante de lui, le pouvoir, abandonné aux passions de la politique, ne représente que le stupide esprit de domination brutale. L’autorité se dévalorise si elle exerce directement le pouvoir politique, alors que dégagée de ses compromissions, elle peut soumettre la loi à l’équité et la politique à la morale. La légitimation du pouvoir temporel par l’investiture sacerdotale a son signe visible dans le sacre des rois. Si les papes avaient exercé le pontificat réel au lieu de convoiter la domination temporelle, ils auraient enseigné aux empereurs leur rôle de magistrat des rois.
Des extraits de la littérature de divers peuples indiquent la prééminence du sacerdoce sur la royauté ; les druides celtiques, les mages persans, les prêtres égyptiens et les brahmanes indiens dominaient sur la royauté. L’autorité des temples d’Égypte instituait et éduquait le pouvoir royal pour faire régner l’équité divine dans l’ordre terrestre[5]. Dans l’ancien monde celtique, la relation harmonieuse qui existait entre la classe des druides et celle des chevaliers transparait dans la légende de Merlin et d’Arthur. Les rois reconnaissaient la préséance aux druides, à qui souvent ils devaient leur couronne. Comme Merlin au temps d’Arthur, le druide en tant que gardien de l’équilibre social, parlait avant le roi et intervenait pour contrer les ambitions excessives des nobles. Si le roi est élu par ses pairs parmi la classe guerrière, les druides veillaient à ce que le choix soit régulier et bénéfique, mais tout en exerçant un contrôle sur la fonction royale, ils y restaient étrangers. Ils ne choisissaient pas à proprement parler le roi ; mais ils influençaient le choix et consacraient l’élection par les rituels[6].

Dans l’ancien monde, le pouvoir social de l’enseignement conférait à chacun, sur examen, le niveau équivalent à sa valeur propre dans la hiérarchie des fonction publiques, jusqu’à la royauté[7]. Dans la Chine ancienne, où l’autorité revenait au collège des Lettrés, tous les degrés s’y obtenaient à l’examen, de même que tous les emplois publics. L’attribution des offices n’était pas à la discrétion du pouvoir politique ; l’empereur n’était pas libre de désigner son premier ministre, ses généraux ou ses hauts fonctionnaires en dehors des individus sélectés pour leurs aptitudes et leur niveau intellectuel par l’examen des corps enseignants, sur lesquels l’empereur n’avait aucun pouvoir. Dans des pays sous l’influence chinoise, comme l’Annam, ce système de sélection aux emplois publics, premier ministre inclus, par des examens à teneur philosophique fut en vigueur jusqu’aux dégâts causés par la colonisation française.
L’anomalie dans l’anarchie politique actuelle, c’est que les détenteurs du pouvoir se sélectent eux-mêmes en s’élevant par la violence et la ruse ou par une coalition d’intérêts. Un pouvoir qui se légitime lui-même ressemble à un étudiant qui se décernerait lui-même ses diplômes. Un homme digne d’exercer la souveraineté ne s’improvise pas ; il se sélecte et s’éduque par un maître qu’il doit avoir au-dessus de lui. Avant de conduire une locomotive, le mécanicien doit satisfaire aux exigences de l’examen et du contrôle ; l’erreur qu’on ne commettrait pas dans les chemins de fer, on la laisse commettre dans la direction des États. C’est l’autorité enseignante qui, en déterminant par l’examen le niveau des individus, doit leur ouvrir les fonctions publiques correspondant à leurs aptitudes.
Le projet synarchique de Saint-Yves ne vise pas à confier le rôle directeur dans la société aux corps enseignants ou aux ministres des cultes. Il ne s’agit pas de remettre le pouvoir entre les mains du prêtre ou du professeur, mais de reconnaître à ceux-ci, en tant que détenteurs de la magistrature morale et de la direction des consciences, la primauté non de leur personne mais de leur fonction. Le caractère normal du pouvoir est d’être soumis à cette autorité, lorsqu’elle tient son rang et remplit son rôle, sous peine pour lui de perdre devant l’opinion publique toute autorisation intellectuelle ou morale. En dehors de cette garantie, le pouvoir passe à l’état maladif et répand la maladie dans tout le corps social.
Les détenteurs du pouvoir ont besoin de connaissances que seule l’autorité peut leur transmettre. Ces connaissances liées à des applications contingentes n’atteignent pas le niveau atteint par les représentants de l’autorité, qui recherchent le savoir pour lui-même et non dans un but pratique. Cette connaissance désintéressée reste néanmoins nécessaire à ceux dont les fonctions relèvent au domaine de l’action[9].
Les grands hommes ne suffisent pas à faire le bien de l’humanité, car la politique pure, qu’elle soit monarchique ou républicaine, en est incapable. Seule une autorité véritable, arrachée de toute compromission avec le pouvoir, peut transformer en génie bienfaisant un homme de talent politique. En dehors de ce contrôle, ses qualités individuelles risquent de produire des catastrophes.
Dans les régimes purement politiques, le pouvoir opère des réformes sous la poussée empirique des intérêts. Une autorité légitime aurait pour fonction d’étudier scientifiquement les projets de réformes, avant de leur donner son aval. Un corps savant autonome, socialement efficace, empêche de commettre certaines fautes imputables à la cupidité irresponsable de dirigeants économiques et politiques, à l’exemple, entre mille, de la pollution de l’air, des eaux et des sols, ou de l’érosion provoquée par le remembrement rural. Le pouvoir temporel concerne le monde du changement, qui n’a pas en lui-même sa raison suffisante ; dès qu’il manque d’une orientation juste, il provoque des désordres.
Un tempérament tourné vers l’action, propre à l’exercice du pouvoir, diffère d’une nature propre à exercer l’autorité, qui suppose des penchants pour la réflexion et la méditation. Mais l’action que n’éclaire pas la connaissance n’est qu’agitation désordonnée. Platon dit que les maux du genre humain ne cesseront pas tant que la sagesse et la puissance politique ne convergeront pas dans l’État à cause des différences de nature de leurs représentants[10]. La métaphore de l’aveugle portant le paralytique évoque les rapports normaux entre les deux instances, dont les domaines sont distincts et complémentaires. Chacun supplée par ses facultés aux lacunes de l’autre ; l’homme du pouvoir engagé dans l’action est aveugle, tandis que le représentant de l’autorité, centré sur la contemplation, est comme immobile. L’apologue souligne toutefois que c’est le paralytique, monté sur les épaules de l’aveugle, qui guide et dirige celui-ci, pour marquer la primauté de la contemplation sur l’action[11].
Le contrôle du pouvoir comporte, quand les circonstances l’exigent, un droit et un devoir de remontrance. Le monarque, n’étant que dépositaire du pouvoir, pouvait perdre cette délégation. Le rôle du sacerdoce ne consiste pas à prêcher la soumission aux gouvernés tout en couvrant l’iniquité des gouvernants. Le « Droit divin », à l’origine, ne consistait pas à couvrir de prétextes religieux les caprices d’un monarque, mais dans la délégation du pouvoir par l’autorité spirituelle, ce qui implique son contrôle par le sacerdoce.
Exemples dans l’histoire
Dans sa Lettre à Louis XIV, Fénelon, archevêque de Cambrai, ose flétrir la politique de guerres de ce roi et l’exhorter à préférer la vie de ses peuples à une fausse gloire. Ses remontrances offrent un plus digne exemple d’autorité authentique que les flatteries courtisanes de Bossuet.
Les textes anciens attestent que les maitres spirituels de Chaldée et d’Égypte savaient rappeler à leurs devoirs jusqu’aux détenteurs de la moindre parcelle de pouvoir. La tradition chinoise exigeait des lettrés qu’ils aient le courage de censurer un pouvoir arbitraire et d’admonester, voire de renverser, un mauvais empereur et ses ministres corrompus ; durant quatre mille ans, le corps des lettrés osa se dresser contre les souverains qui tendaient à rendre leur pouvoir personnel[12]. La Bible montre Samuel, après avoir sacré Saül roi, réprimander ce monarque perverti par le pouvoir[13], comme le fera Nathan vis-à-vis de David[14]. Dans la Chrétienté du Moyen Age, les papes pouvaient délier de leur devoir d’obéissance les sujets d’un souverain qui contrevenait à ses devoirs.
En l’absence même d’une procédure répressive, le simple désaveu public peut désarmer les gouvernants en les discréditant auprès des gouvernés. Il suffit que l’autorité puisse en appeler à la conscience publique pour dissuader n’importe quel dirigeant de risquer d’en arriver à une situation aussi inconfortable.
[1] Saint-Yves d’Alveydre, Mission des Juifs, Ed. Traditionnelles, Paris, 1981, p. 41.
[2] René Guénon, Autorité spirituelle et Pouvoir temporel, Véga, Paris, 1984, p. 27-28.
[3] Julius Evola, Révolte contre le monde moderne, Ed. de l’Homme, Montréal, 1972, p. 126.
[4] Mânavadharmacâstra XI, 31-34.
[5] Saint-Yes d’Alveydre, Mission des Juifs, Ed. Traditionnelles, Paris, 1981, p. 377.
[6] Françoise Le Roux, Les Druides, PUF, Paris, 1961.
[7] Saint-Yves d’Alveydre, Mission des Juifs, Ed. Traditionnelles, Paris, 1981, p. 648.
[8] Dernière phrase de son livre, La Formation de l’esprit scientifique.
[9] René Guénon, Autorité spirituelle et Pouvoir temporel, Véga, Paris, 1984, p. 39-40.
[10] Platon, République, V, 18.
[11] René Guénon, Autorité spirituelle et Pouvoir temporel, Véga, Paris, 1984, p. 67-68.
[12] Saint-Yes d’Alveydre, Mission des Juifs, Ed. Traditionnelles, Paris, 1981, p. 230.
[13] 1 Samuel XIII, 13-14.
[14] 2 Samuel XII, 1-15.
