
La Révolution française, et plusieurs de ses leaders, ont été inspirés par le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Son incontestable talent d’écrivain avait permis à cet auteur d’accréditer, à son époque, des idées aussi aberrantes que celle selon laquelle l’homme naturel est bon, c’est la société qui le corrompt et qui crée les inégalités, les injustices et la violence. Selon lui, tout sortait parfait de la nature et tout se détériorait avec la civilisation ; pour retrouver sa bonté naturelle, l’homme devait revenir à l’état de pure nature. Sous la Révolution, les plus acharnés ont voulu, à la suite de Rousseau, faire retourner la civilisation à la condition du bonheur initial en rendant ses droits à la nature, dont la pureté primitive aurait été outragée par les lois, les sciences et les cultes. Cependant, ce même auteur, d’une réelle intelligence, a également produit des réflexions d’une grande lucidité sur le lien social et sur les institutions politiques.
Rousseau a vu dans l’état social la Volonté humaine consacrant la souveraineté du peuple. L’ordre social résulte, selon lui, d’une association volontaire instituée par la volonté libre des individus. On a invoqué ses thèses sur la souveraineté populaire pour justifier ce qu’il voulait précisément dénoncer : le système représentatif, alors que Rousseau n’a que des mots sévères pour le parlementarisme anglais, qui arme les députés d’une puissance incontrôlée pour les sept années que dure leur mandat[1]. Les idéologies républicaines font découler le pouvoir d’une délégation du peuple, alors que toute représentation dépossède les électeurs de leur existence politique. Le peuple n’est libre que le jour de l’élection de ses représentants ; sitôt après, il n’est plus rien ; en votant, il abdique de sa liberté. Le vrai régime républicain ne peut exister que là où le peuple s’assemble pour désigner ses magistrats en direct, et non par délégation interposée.
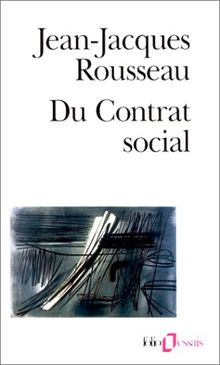
La garantie élémentaire des libertés exige certes que le pouvoir de légiférer échappe aux détenteurs de l’exécutif, mais Rousseau voit tout autant le danger d’un corps représentatif qui se subordonne la puissance législative. Tout en défendant la souveraineté populaire, Rousseau perçoit bien qu’un pouvoir, qui n’admet ni arbitre ni recours, ne connaît ni limite ni contrepoids, et conduit inévitablement au despotisme. La souveraineté populaire, principe essentiel de toute république, ne se délègue pas, car dès qu’on admet qu’elle peut être représentée, on ne peut plus empêcher ses représentants de la confisquer. Le seul moyen de prévenir l’usurpation du pouvoir consiste dans l’assemblée périodique du peuple pour juger de l’usage qui en a été fait, et pour décider s’il convient de changer ceux qui l’exercent. C’est au peuple présent en assemblée, et non pas représenté, que doit revenir le pouvoir de fixer les règles, car toute délégation d’une fonction de pouvoir, comme celle de légiférer, armera un despote. Rousseau n’attend pas de l’assemblée populaire qu’elle sache codifier la législation ; mais il veut lui laisser le moyen d’empêcher un pouvoir habilité en permanence de confisquer l’arme législative, ainsi que la possibilité de repousser les lois qui lui paraissent injustifiées.
On a repris de Rousseau l’idée, souvent mal comprise, de la volonté générale. Trop souvent, on entend la volonté générale comme la somme des volontés individuelles, alors que Rousseau souligne sa différence d’avec la « volonté de tous ». Selon lui, il s’agit d’une volonté unique, dégagée de toute subjectivité. La volonté générale est droite et tend toujours au meilleur et à l’utilité publique ; dotée d’un instinct infaillible, elle sait reconnaître si les lois sont conformes au bien commun. Elle est présente en chaque homme mais elle y est occultée par ses passions. Rousseau insiste sur le fait que la volonté générale ne peut pas être déléguée sans être aliénée. C’est la consultation du peuple en assemblée qui lui permet de s’exprimer à travers chacun, en empêchant les facteurs passionnels de primer.
Rousseau ne se dissimule pas que la méthode est inapplicable sur une grande échelle ; il raisonne par référence à des collectivités de dimensions modestes, les seules qui rendent possible au peuple de se réunir pour empêcher le pouvoir de confisquer à la volonté générale l’arme législative. Et même dans une collectivité de taille réduite, il se reconnait impuissant à concevoir la démocratie et la souveraineté populaire, car le peuple ne peut pas rester continuellement assemblé pour vaquer aux affaires publiques.
Saint-Yves d’Alveydre donnera une réponse à cette question de la souveraineté en affirmant qu’elle ne peut pas être politique et gouvernementale, mais sociale et professionnelle ; dans la loi synarchique, elle se définit par les trois pouvoirs électoraux des gouvernés constitués en face des gouvernants.
[1] Considérations sur le Gouvernement de Pologne et sa réformation projetée en 1772, chapitre VII.
